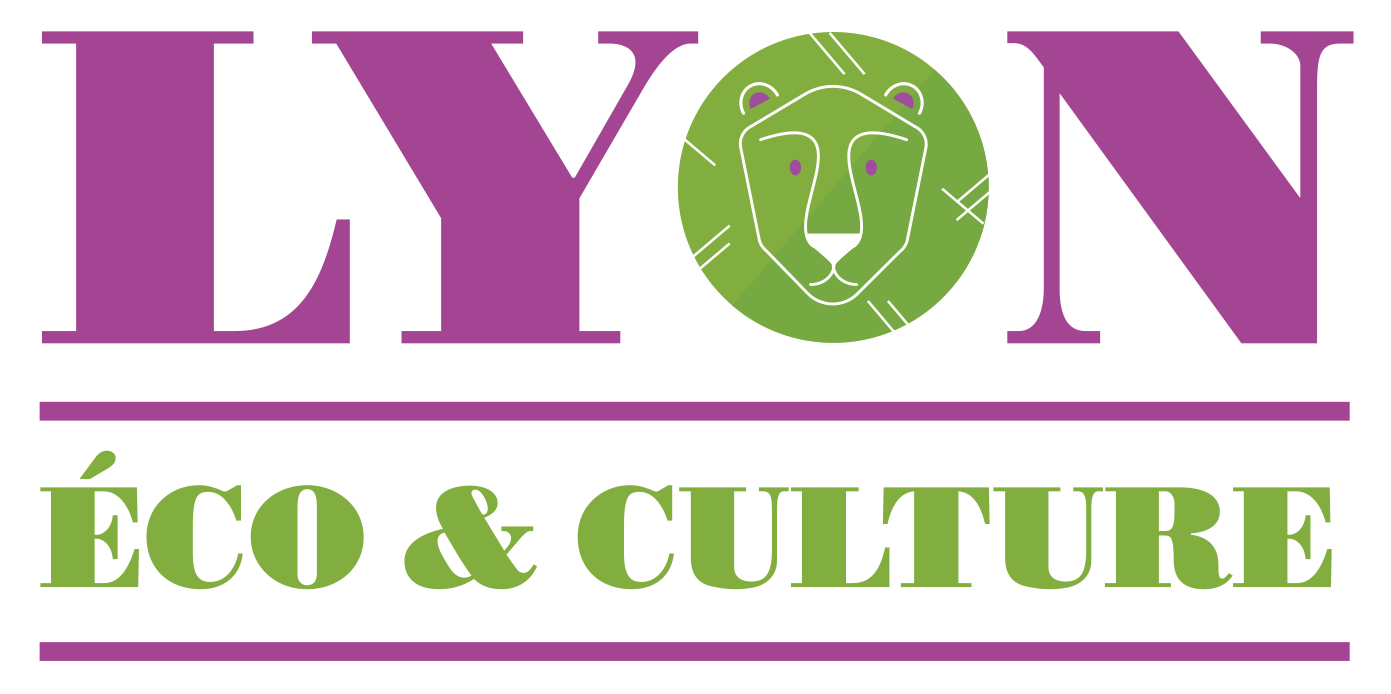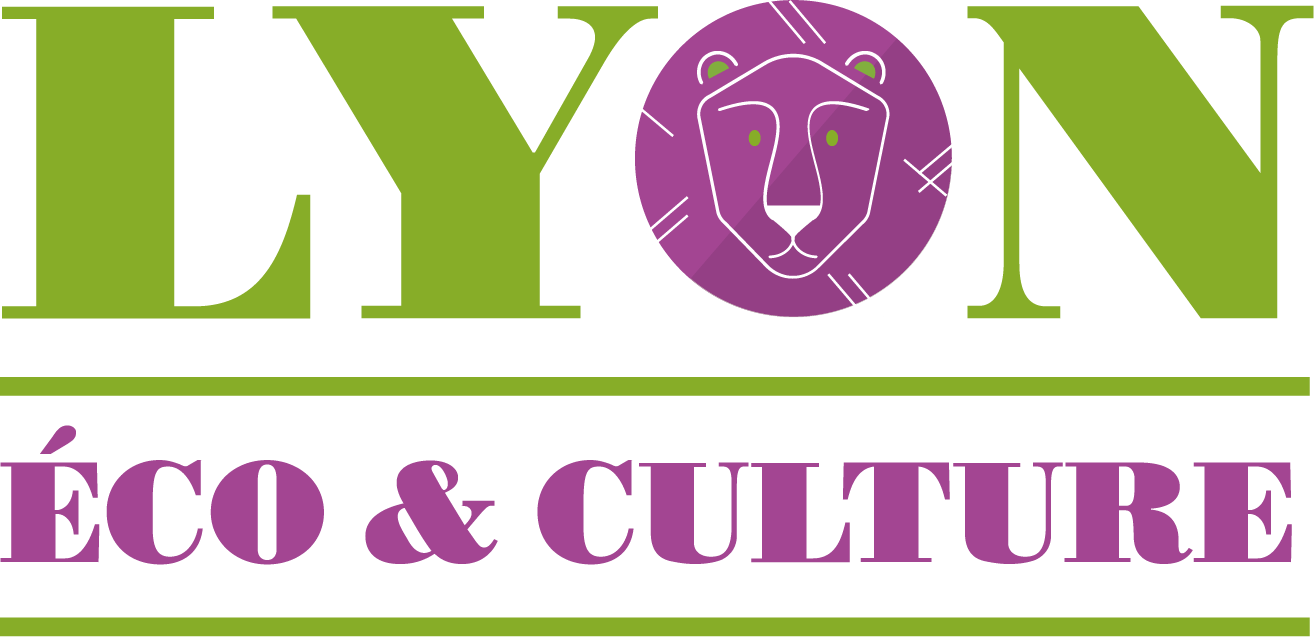Pourquoi les CESER sont essentiels au fonctionnement des régions
#ceser
CESER – Conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux : une instance utile mais menacée
Une onde de choc traverse les régions françaises. Le 25 mars dernier, deux amendements adoptés par la commission spéciale de l’Assemblée nationale ont semé l’inquiétude : ils visent tout bonnement à supprimer les CESER, ces conseils régionaux consultatifs qui, depuis plus de 50 ans, donnent une voix à la société civile dans l’élaboration des politiques publiques.
Derrière cet acronyme un peu austère – CESER pour Conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux – se cache pourtant un pilier discret mais crucial de la démocratie territoriale.
En Auvergne-Rhône-Alpes, ils sont 190 conseillers issus de 122 organisations à plancher, dans l’ombre, sur les grands défis régionaux : emploi, environnement, santé, ruralité, mobilité…
Un travail d’analyse et de prospective rarement médiatisé, mais souvent décisif.
Ces instances consultatives, parfois perçues comme technocratiques, sont en réalité des espaces rares de dialogue pluraliste. Elles réunissent des représentants du monde économique, syndical, associatif, scientifique ou encore environnemental, dans un esprit de construction collective.
À rebours du climat de polarisation politique ambiant, les CESER permettent à des acteurs très différents – voire opposés – de débattre sans s’affronter, de chercher des compromis, de faire émerger des propositions concrètes sur des sujets complexes.
Leur fonctionnement non partisan et leur enracinement local en font des lieux d’écoute mutuelle, de réflexion approfondie et d’élaboration partagée, que peu d’instances peuvent aujourd’hui revendiquer.
Si les CESER ne disposent d’aucun pouvoir décisionnel, leur influence est bien réelle. Leurs travaux alimentent directement les réflexions et décisions des conseils régionaux.
En Auvergne-Rhône-Alpes, près de 60 % des avis et rapports du CESER sont repris, en tout ou partie, par l’exécutif régional. Leurs apports ne se limitent pas à commenter les politiques publiques : ils contribuent aussi à les anticiper et à les évaluer, en apportant un éclairage de terrain et une vision transversale.
Ces dernières années, leurs contributions ont concerné des sujets aussi stratégiques que la transition énergétique, les mobilités durables, l’accès aux soins ou la formation professionnelle. Ils jouent également un rôle croissant dans l’évaluation des politiques régionales, renforcé par les lois NOTRe (2015) et 3DS (2022), qui ont conforté leur légitimité.
Le président du CESER Auvergne-Rhône-Alpes, Antoine QUADRINI, en appelle à laresponsabilité des parlementaires pour préserver ces instancesqui participent activement à la construction des politiquesrégionales, et pour porter une évolution à la hauteur des défisdémocratiques, économiques, sociaux et environnementaux denotre époque.
Acteur majeur de la vitalité démocratique locale, le CESER est unpilier de la co-construction de l’action publique régionale. Le supprimer reviendrait à affaiblir considérablement la place et lerôle des corps intermédiaires dans la société.
Le coût de leur fonctionnement, souvent brandi comme un argument pour justifier leur suppression, apparaît pourtant modeste au regard de leur utilité. Le budget total des CESER à l’échelle nationale est estimé entre 50 et 60 millions d’euros par an, soit à peine 0,1 % du budget moyen des régions.
En comparaison, les économies potentielles semblent dérisoires, surtout si l’on prend en compte les dizaines de rapports produits chaque année, l’apport de centaines d’experts bénévoles et l’effet levier que ces travaux peuvent avoir sur les politiques publiques.
En Auvergne-Rhône-Alpes, on compte plus de 200 experts mobilisés ponctuellement pour appuyer les réflexions du CESER, enrichissant encore la diversité des points de vue.
La perspective d’une suppression pure et simple a suscité une levée de boucliers inhabituelle, unissant syndicats, patronats, associations, élus de tous bords et universitaires. Tous dénoncent un recul démocratique majeur et un affaiblissement du lien entre les citoyens et les politiques publiques.
Dans un contexte où la demande de participation citoyenne n’a jamais été aussi forte, cette décision est perçue comme un non-sens. Elle fragiliserait un outil éprouvé, justement au moment où les territoires ont besoin de dialogue, d’anticipation et d’agilité face aux transitions à venir.
Car les CESER sont bien plus qu’un simple appendice institutionnel. Ils sont le reflet vivant de la diversité sociale et territoriale des régions. On y retrouve des jeunes, des retraités, des personnes en situation de handicap, des ruraux, des urbains, des professionnels et des bénévoles, tous engagés pour construire des diagnostics communs.
Leur disparition ne signifierait pas seulement la fin d’une institution : elle marquerait la rupture d’un lien précieux entre les citoyens et leurs territoires, entre l’expertise de terrain et les politiques publiques.
Alors que plusieurs pays européens renforcent leurs instances de concertation régionales, la France semble prendre le chemin inverse. Pour nombre d’observateurs, cette décision traduit un malaise démocratique plus profond, une centralisation rampante et une volonté de recentrer la décision publique sur un cercle restreint d’acteurs.
Mais la mobilisation actuelle, inédite par son ampleur et sa diversité, pourrait bien rebattre les cartes. Les CESER, forts de leur expérience, ne comptent pas disparaître en silence.