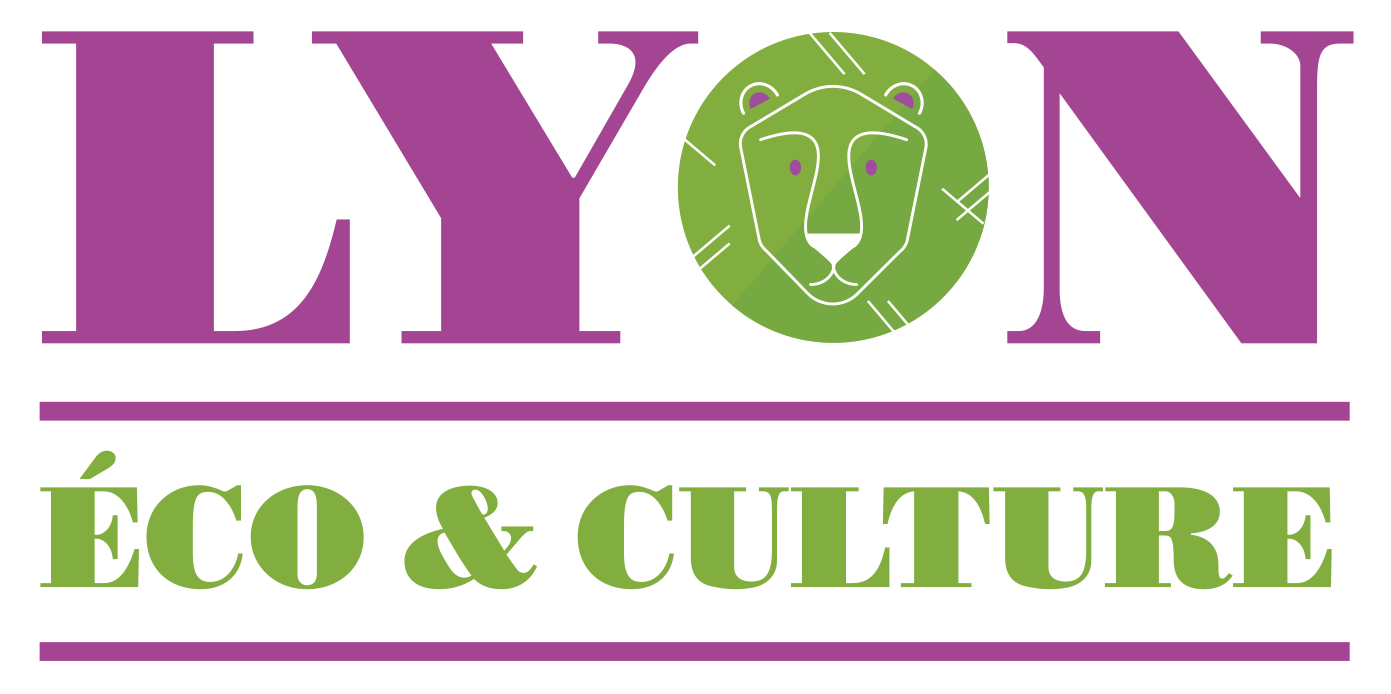La crise sanitaire que nous traversons nous oblige à repenser nos modalités de communication et d’échanges. Ce qui n’est pas sans poser un certain nombre de problèmes, car comme le rappelle Dominique Wolton « informer n’est pas communiquer ». Aussi, l’avancée technologique excelle dans la transmission des informations à distance, mais ne saurait pallier notre besoin de sociabilité : nous sommes des êtres sociaux de communication.
Pour autant, le télé-travail et la visioconférence semblent satisfaire une grande partie des français pour qui l’échange de données et des informations peut se réaliser à distance. Seule exigence, ces échanges reposent sur un postulat fondamental : la confiance. A l’heure actuelle, même si le déconfinement se réalise progressivement, les échanges digitaux restent favorisés, en apportant parfois son lot de difficultés au sein des entreprises, notamment sur la gestion relationnelle. Le problème que nous rencontrons à accepter le télétravail ou la visioconférence dans nos vies professionnelles semble donc davantage idéologique et psychologique que technique et numérique. Décryptage.
Accorder sa confiance, une question de personnalité
On l’oublie souvent, surtout au pays des Droits Universels, mais nous ne naissons pas tous égaux. Nos comportements, beaucoup plus stéréotypés que ce que l’on croit, dépendent en partie de notre personnalité. Et en la matière, nous n’accordons pas tous notre confiance aussi facilement.
Comme le rappelle le Dr Jacques Fradin dans ses travaux : « La personnalité est constituée de traits de personnalité qui sont : pour les uns définitifs, c’est-à-dire ineffaçables, issus de notre génétique et de notre empreinte poste-natale ; on les nomme tempéraments ; pour les autres, acquis tout au long de la vie par un processus de mémoire émotionnelle, néo-limbique (…) on les nomme caractères. » (L’Intelligence du stress, 2008).
La manière dont nous nous positionnons instinctivement les uns par rapport aux autres est instinctive, pulsionnelle et a-morale. Ce positionnement grégaire est en grosse partie dirigé par le « Système 1 », comme l’appelle le Prix Nobel de 2002 Daniel Kahneman, et principalement composé des régions reptiliennes et limbiques. Et ce positionnement n’est pas très original en soi, on peut le résumer à 4 grandes positions ou « sémiotypes » (détaillés dans cette vidéo).
Les personnalités plus introverties accordent moins facilement leur confiance. Prenons les deux sémiotypes les plus illustratifs afin d’aborder cette question de la confiance. Précisons, il s’agit de décrypter et comprendre certaines dynamiques comportementales sous-jacentes, de porter un regard davantage clinique, voire biologique, que moraliste ou normatif. Le sémiotype du « vigilant », par exemple, est solitaire par nature et se ressource dans des activités individuelles.
Le confinement a été une période bénie pour ce sémiotype : plus de rapports sociaux obligatoires, plus d’intrusion inopinée dans sa sphère intime, la jouissance de son temps et de son espace en toute autonomie. Le sémiotype du pragmatique, quant à lui, peut se révéler un véritable petit « chefaillon » tant son besoin de contrôle est grand.
En réalité, c’est le côté très procédural et réglementaire du pragmatique, sa révulsion à l’inattendu et au changement, qui peut le rendre (très) difficile à gérer pour son entourage professionnel. Pour ces deux sémiotypes en particulier, la gestion à distance des équipes peut être infernale et épuisante. Le pragmatique, s’il ne peut plus voir / suivre ses équipes, va en déduire immédiatement que le travail n’est pas fait.
Le vigilant pourrait, quant à lui, prendre des décisions de manière unilatérale, sans consultation préalable. Notez bien qu’il ne s’agit pas ici de porter un jugement moral, simplement de mettre en exergue certains ressorts de personnalité en difficulté face à l’essor du télé-travail.
En la matière, les chiffres font froid dans le dos : 44% des salariés ont été en situation de détresse psychologique pendant le confinement, et selon le Baromètre “Impact de la crise sanitaire sur la santé psychologique des salariés” réalisé par Opinion Way. Un taux qui pourrait notamment s’expliquer par les effets des procédures de contrôle, accentuées lors de la période de confinement, augmentant le stress des collaborateurs: « Ça passe par du reporting, qui crée aussi de la défiance et, à l’excès, génère perte d’estime de soi et culpabilité (…) du côté du manager, une absence de réponse ou une réponse tardive peut être interprétée comme du désengagement. Mais appeler tous les matins pour savoir ce qui a été fait est nuisible », rappelle M. Goata, psychologue, au journal du Monde (« « Franchement j’en ai ma dose » : le télétravail use de nombreux salariés »).
La défiance, un imaginaire français
S’ajoute un autre paradigme, venant compléter les ressorts de personnalité : notre héritage historique en tant que français. L’historien Jean Sellier nous le rappelle, au-delà des différences linguistiques, « un peuple c’est d’abord un imaginaire commun ». Et cet imaginaire s’incarne à travers des mythes fondateurs, une histoire à se raconter de génération en génération (interview à lire ici). De ce point de vue, il est indispensable de comprendre sur quels imaginaires la France s’est construite. Voici trois événements marquants et cinglants qui semblent éclairants quant à notre manière de considérer les liens relationnels.
1 – Rappelons-le, l’Inquisition est d’abord née en France, et non en Espagne comme on se l’imagine souvent… L’anthropologue et philosophe Fernand Felix Schwartz nous le rappelle : il s’agit de L’Inquisition des cathares en 1237.
2- Plus tardivement, et peu après la Révolution Française, c’est le règne de la Terreur : plus personne ne peut faire confiance à personne, sous peine de passer à la guillotine.
3- Au moment de la Seconde Guerre Mondiale, la Collaboration bien sûr. Une France coupée en deux géographiquement, idéologiquement et moralement.
Ces événements historiques, non exhaustifs, sont représentatifs d’un certain héritage symbolique que l’on se saurait réduire à l’anecdote : ils ont façonnés l’imaginaire du peuple français. Bien sûr, de nombreux exemples existent également chez nos voisins européens. Il semble tout de même que la figure du « corbeau » incarne bien cet imaginaire français de la méfiance et de la suspicion.
D’ailleurs certains quotidiens étrangers ont souligné la recrudescence des lettres de dénonciations pendant le confinement (Article de Courrier International, « vu d’Autriche » ).
Voici la définition proposée par Alain Peyrefitte : « La société de défiance est une société frileuse, gagnant-perdant : une société où la vie commune est un jeu à somme nulle, voire à somme négative (si tu gagnes, je perds) ; société propice à la lutte des classes, au mal vivre national et international, à la jalousie sociale, à l’enfermement, à l’agressivité de la surveillance mutuelle.
La société de confiance est une société en expansion, gagnant- gagnant, une société de solidarité, de projet commun, d’ouverture, d’échange, de communication. » (La Société de confiance, 1995). Les travaux des économistes Cahuc et Algan le confirme : la société de défiance est d’abord un mal français. Construit sur des bases étatistes et corporatistes, la modèle français ne favorise pas la confiance entre les individus. Le corporatisme qui associe droits sociaux en fonction d’un statut ou d’une profession « opacifie les relations sociales ». Et l’étatisme qui « consiste à réglementer tous les domaines de la société civile » favorise la corruption.
Le résultat est sans appel : par rapport aux autres pays de l’OCDE, la France est en queue de peloton sur la question de la confiance : « seuls 21 % des Français déclarent faire confiance aux autres, soit plus de trois fois moins que dans les pays nordiques. Sur les vingt-six pays de l’OCDE recensés, la France se classe au 24e rang. » (La Société de défiance, 2007).
De part son étymologie, notons que le terme « défiance » n’est pas synonyme du mot « méfiance ». Au Moyen-âge, le mot défiance contient le verbe « abandonner », « renier » (v.1130, desfier). La défiance est donc un « mal » plus grand que la méfiance : elle est démissionnaire. Et comme nous le rappelle Alain Rey dans son Dictionnaire de la langue française, l’origine du mot signifie également que « l’on renonce à la foi jurée », rappelant ainsi que la confiance est aussi une histoire de croyances. On ne fait pas confiance sur preuves, mais dans l’incertitude, et « sans savoir ».
Plus récemment, le terme « défiance » se rapproche de sa racine « défi », utilisée comme synonyme de l’anglais challenge pour désigner « un obstacle que doit surmonter une civilisation dans son évolution ». Voici donc, dans l’histoire du mot « défiance », un indice de ce défi civilisationnel qui nous attend, donner sa confiance les yeux fermés, un enjeu sans doute accru par l’intrusion exponentielle de l’IA dans notre vie quotidienne.
La confiance, ça se mérite ?
C’est un adage bien connu : « la confiance ça se mérite ». N’en déplaise à la sagesse populaire, la confiance ne se mérite pas, elle se donne ! Et c’est en tous les cas la conclusion d’Anatol Rapoport, ce psychologue et philosophe américain d’origine russe, figure de proue de la « théorie des jeux ».
Vous avez déjà sans doute entendu parlé de ce dilemme du prisonnier : deux personnes enfermées ont davantage intérêt à coopérer entre elles plutôt que se dénoncer mutuellement afin de maximiser leurs gains. Réalisé à grandes échelles et de manière multipliée grâce à l’intelligence artificielle, les résultats confirment l’injonction de Rapoport : « Cooperate on move one ; thereafter, do whatever the other player did the previous move. (Traduction : « Coopère sur le premier mouvement, et ensuite fait exactement ce que l’autre joueur fait »). Et cela, les meilleurs négociateurs au monde le savent bien : la confiance ça se donne d’entrée de jeu.
C’est un souvenir qui m’aura marqué : il y a quelques années, j’ai eu la chance d’être immergée pour un laps de temps (trop court) au sein de la cellule négociation du RAID, et d’être formée par des noms respectables au sein de la police judiciaire.
Contrairement à ce que l’on pense, une négociation face à un « fou », à un « forcené » ou encore à un « terroriste » demande beaucoup plus d’agilité relationnelle que de biceps. Autrement dit, le mode de négociation « conquérant » façon Donald Trump n’a pas que des avantages : « My style of deal-making is quite simple and straightforward. I aim very high, and then I just keep pushing and pushing and pushing to get what I’m after. » (Traduction : Mon style de négociateur est assez simple et direct. Je vise très haut, puis je continue à pousser et à pousser pour obtenir ce que je recherche.» in The Art of the deal.) Avec ce « style », une négociation où des vies sont en jeux a bien plus de chance de finir en carnage. Afin d’éviter cela, les négociateurs travaillent leur posture. Ils savent mettre de côté leurs valeurs et convictions dans la dynamique relationnelle pour entrer dans le référentiel de l’autre, c’est-à-dire intégrer le point de vue l’autre. Ils changent ainsi leurs « lunettes au monde », sans pour autant faire preuve d’empathie.
En effet, il ne s’agit pas d’être compatissant ou affecté (c’est-à-dire du domaine axiologique Bien / Mal, Beau / Laid…), mais de comprendre les codes de ses interlocuteurs (c’est-à-dire du domaine de l’intelligence relationnelle). Et cette dynamique relationnelle ne peut avoir lieu sans un minimum d’échanges et de confiance entre les parties prenantes.
Cas extrême s’il en est, cette posture de confiance a moins à voir avec de l’empathie ou bien de la compréhension (le fait de prendre l’autre avec soi), qu’avec l’assertivité (concept déployé par le psychologue Andrew Satler : se faire respecter et respecter). Faire confiance, c’est ainsi donner à l’autre sans présager d’un déroulé futur et aviser à chaque étape, afin d’ajuster la réponse adéquate.
Aussi, la fin de la phrase de Rapoport (« coopère sur le premier mouvement, et ensuite fait exactement ce que l’autre joueur fait ») semble un conseil judicieux pour ne pas tomber dans le « béni-oui-oui », une autre tendance fâcheusement française ? Régis Debray nous rappelle dans son ouvrage Civilisations : « Les Français doutent de leur archétype, mais leurs traits particuliers ne font aucun doute pour les étrangers, en particulier anglo-saxons, qui nous observent, lisent ou visitent : arrogant, prétentieux, se croyant plus intelligent qu’il n’est, et crado en plus. Version haute : beau parleur, non sans charme. Version basse : hâbleur et faux jeton, doué pour la trahison (voir films et séries). » Décidément cet « idéal-type » du diplomate français louvoyant, peu à même de donner sa confiance et de la recevoir en retour, semble plus qu’un imaginaire : un bagage, pour ne pas dire une casserole.
Écrit par Elodie Mielczareck, Sémiolinguiste, spécialisée dans le langage verbal et non verbal
Auteure de « Déjouez les manipulateurs », Editions du Nouveau Monde, 2016. Et de « La Stratégie du Caméléon », Cherche Midi, 2019.
http://www.analysedulangage.com
Similaire